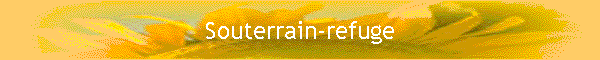"M. le Comte Bégouen (Toulouse) - Ayant été avisé qu'un
Souterrain-Refuge avait été découvert dans le domaine de Bazert, commune
de Muret (Haute-Garonne), je m'y suis rendu le 16 janvier 1913. Très
aimablement accueilli par le propriétaire, M. Camps, j'ai pu recueillir
tous les renseignements désirables, visiter le souterrain, prendre
notes, mesures, croquis et photographies : bref réunir les premiers
éléments d'une étude qui sera continuée, s'il y a lieu.
"M. le Comte Bégouen (Toulouse) - Ayant été avisé qu'un
Souterrain-Refuge avait été découvert dans le domaine de Bazert, commune
de Muret (Haute-Garonne), je m'y suis rendu le 16 janvier 1913. Très
aimablement accueilli par le propriétaire, M. Camps, j'ai pu recueillir
tous les renseignements désirables, visiter le souterrain, prendre
notes, mesures, croquis et photographies : bref réunir les premiers
éléments d'une étude qui sera continuée, s'il y a lieu.
L'existence de ce souterrain était absolument ignorée dans le pays :
c'est il y a quelques mois, au moment des labours, qu'elle fut révélée
de la façon ordinaire : un bœuf sentant le sol s'effondrer sous lui et
faisant un brusque écart. Le laboureur sonda le trou qui lui parut
profond et prévint le propriétaire, M. Camps. On fit un sondage. Sous la
couche de terre arable de 0m40 environ, on rencontra le tut sablonneux
inférieur creusé en escalier. Celui-ci se dirige d'abord du Nord au Sud,
puis fait un coude à angle droit vers l'Ouest après un petit palier.
Tout l'escalier paraît avoir été jadis à l'air libre, en ce sens qu'il
n'a pas été creusé sous le roc. Au haut des parois latérales de la
dernière partie le tuf présente une sorte de feuillure, destinée sans
doute à recevoir un toit formé soit de plaques de pierre, soit de
morceaux de bois. M. Camps a recueilli un bloc de grès ronge ayant la
forme d'un quart de circonférence qui a bien pu servir pour fermer une
partie de l'entrée. Le souterrain s'ouvre en bas des marches par une
porte mesurant 0m80 de largeur sur environ 3 mètres de hauteur. Après
l'entrée, le couloir se rétrécit et s'abaisse.
Tout le monument est très bien conservé : ce qui s'explique par la
nature de la pierre dans laquelle il est creusé, un tuf sableux se
travaillant facilement, tout en étant très solide. La trace des outils
est visible en plusieurs endroits. On voit nettement près de l'entrée
les encoches ayant servi à maintenir les portes et les barricades mais
il n'y en a pas à l'intérieur.
De petites niches triangulaires ou arrondies sont creusées dans les
parois. Ce souterrain-refuge ne renferme que deux chambres ; toutes les
deux sont rectangulaires, vastes et élevées. Il y a plusieurs galeries;
l'une d'elles revenant vers le Sud est terminée par une chambre dont la
paroi est percée de trois conduits, aboutissant dans le couloir en face
de l'escalier : ce qui permettait de surveiller l'entrée depuis la
chambre la pins reculée; cette disposition se retrouve dans la plupart
des nombreux souterrains-refuges du Midi.
Ces conduits sont rectilignes, percés les uns au-dessous des autres,.
ils ont un diamètre moyen de douze centimètres et une longueur de 1m15.
La voûte parait en ogive, par suite d'une légère dégradation des
plafonds mais, là où ne s'est pas produit d'éboulis, on voit que les
plafonds étaient formés de deux pans inclinés.
L'angle d'ouverture est plus aigu dans les couloirs que dans les
chambres, la flèche de la voûte ayant partout 0m50, tandis que
l'écartement des parois est variable. Une rainure en ligne droite marque
l'endroit où commence le plafond.
A l'examen du plan, on voit combien tout a été fait au cordeau, et à
l'équerre. C'est là une des caractéristiques des monuments de ce genre
dans le bassin de la Garonne. Cela permet de supposer qu'ils sont moins
anciens que ceux des autres régions de la France, en particulier de la
Vendée, du Poitou, de l'Artois ou de la Picardie. Ceux-ci, malgré la
complication parfois plus grande de leurs plans, trahissent moins de
sûreté et de perfection dans leur exécution. Le souterrain de Bazert est
d'ailleurs le plus régulier de tous ceux que je connais.
Dans la chambre Nord, sur la paroi Ouest, un conduit oblique de 0m25
de diamètre servait de cheminée d'aération. Il est bouché par les terres
à plus de deux mètres de son orifice. Au-dessous de lui la paroi est
creusée en demi-cercle, comme pour former un foyer. Sur les murs de
cette chambre sont tracées quelques croix, qui attestent l'occupation de
ce souterrain à une époque relativement récente, au temps des Albigeois
par exemple. C'est ce qui résulte également des quelques débris de
poterie recueillis dans les terres de déblai, soit par le propriétaire
M. Camps, soit par M. Decap ou moi.
Si quelques-uns, de poterie noire très grossière, n'ont pas d'âge et
peuvent s'appliquer aussi bien à la mauvaise céramique barbare qu'à des
poteries plus récentes, le plus grand nombre des tessons recueillis sont
en terre grise, sonore, bien recuite, provenant incontestablement du
moyen âge. Un fragment ornementé et la forme des rebords confirment
cette attribution de date.
L'eau qui avait envahi le souterrain rendait son exploration
difficile et forcément incomplète ; mais comme elle provenait non d'une
nappe phréatique, mais des pluies, la pompe d'épuisement que fit
installer le propriétaire (qui dirige les travaux avec une intelligence
et un zèle louables) en eut facilement raison. Nous pûmes donc visiter
en entier ce souterrain, qui n'est ni plus vaste ni plus compliqué que
tous ceux qui jusqu'ici ont été découverts dans la région, à
Gaillac-Toulza par exemple.
M. Decap, instituteur à Muret et mon collègue à la Société
archéologique du Midi de la France, en qualité de membre correspondant,
a bien voulu m'accompagner dans la visite de ce souterrain et m'aider
pour le relevé du plan ci-contre (Fig. 1), sur lequel il a marqué avec
soin toutes les mesures et toutes les particularités : ce qui me
dispense d'une trop minutieuse description. Ce souterrain est situé sur
le versant Est de la basse colline qui sépare les vallées de la Garonne
et de la Lousse, dominant en quelque sorte cette dernière. Le monticule
devait être boisé (il y reste encore quelques bouquets d'arbres) et le
souterrain se trouvait ainsi à l'orée du bois, surveillant la
plaine.
Figure 1- Plan du Souterrain de Bazert, commune de Muret
(Haute-Garonne)
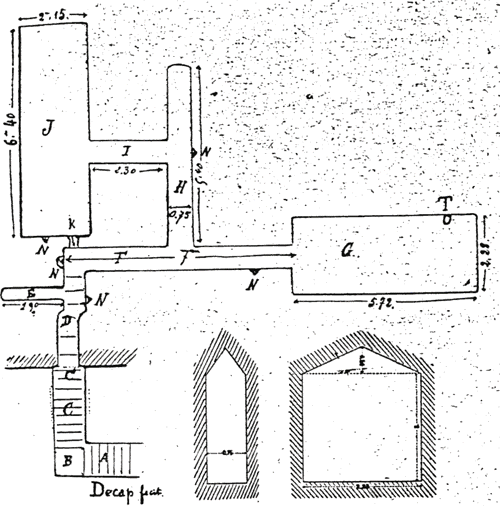
![[Logo de l'entreprise]](../agriculture/logo.gif)